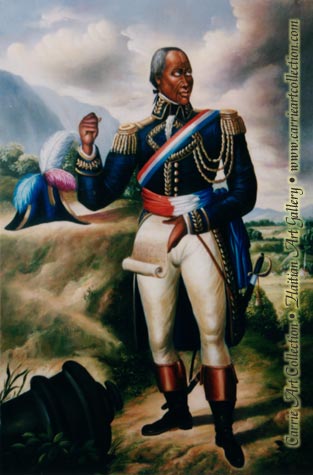|
||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti( Ayiti) mwen renmen e map fè tout sam kapab poum ede-w sorti nan mizè ou ye ya. Li met piti kou li.
Politisyen Ayisyen ak tout lot ayisyen an nou pran konsyans poun ka sove peyi nou. Pou-n kormanse an-n di tankou Salmon P Chase 1861 " Dear Sir: No nation can be strong except in the strenght of God, or safe except in His defense. The trust of our people in God should be declared on our national coins". Sa pavle di pou-n ekri minm bagay sa sou lajan-n. Min poun met BonDye an Premye e narive

- 9:03Added to
queue Jean Claude duvalier Interview in Paris(the fir...28,668 viewshaitianhistory 
- 10:00Added to
queue Jean Claude Duvalier 25 years old 1976 114,757 viewswilnernau 
- 6:04Added to
queue Jean Claude Duvalier 1971-26,056 viewswilnernau 
- 0:56Added to
queue Beaute d'Haiti2,443 viewsmannofresh86 
- 4:46Added to
queue Papash - Gade Yo22,946 viewsemmanuel2008read 
- 5:54Added to
queue Francois Duvalier (Papa Doc) 196890,750 viewswilnernau 
- 6:04Added to
queue Des étudiants Haitian en 19593,688 viewswilnernau 
- 3:59Added to
queue Haiti in the 70's (ABC's Harry Reasoner 1975) p...3,523 viewshaitianhistory 
- 9:40Added to
queue 26th Anniversary of the VSN344,184 viewswilnernau 
- 2:52Added to
queue 2009 WISHES FROM JEAN CLAUDE DUVALIER (BABY DOC)47,222 viewsTeleLakaytv 
- 1:56Added to
queue Death of Francois "Papa Doc" Duvalier (1971)4,468 viewsRealAgentOfSHIELD 
- 3:56Added to
queue Jean-Claude Duvalier s'enfuit d'Haïti (7 févrie...22,200 viewswilnernau 
- 5:26Added to
queue Jean Claude Duvalier74,992 viewswilnernau 
- 1:38Added to
queue Députe Bourjolly se Fache à l'assemblée Nationale1,427 viewsArchivexHaiti 
- 7:19Added to
queue Jean Claude Duvalier 1976 26,306 viewswilnernau 
- 1:07Added to
queue Jean Claude Duvalier and Michele Bennet36,305 viewswilnernau 
- 1:42Added to
queue JEAN CLAUDE DUVALIER HAITI3,967 viewsreiaugustus 
- 12:58Added to
queue - HAITI NEWS NOUVEAU GOUVERNEMENT-GUEDES AU CIMET...4,107 viewsVALABAB
- 5:26Added to
queue - La famille Haitienne19592,428 viewswilnernau

- 6:04Added to
queue Jean Claude Duvalier and Michele Bennet Weddin...129,124 viewsFeatured Videowilnernau 
- 9:40Added to
queue 26th Anniversary of the VSN344,184 viewswilnernau 
- 1:11Added to
queue Francois Duvalier funeral 197148,457 viewswilnernau 
- 2:39Added to
queue Papa doc video /offthesetTV47,648 viewsofftheset1 
- 8:20
- Added to
queue Francois Duvalier (Papa Doc) 1968 Part-242,031 viewswilnernau 
- 9:22Added to
queue HAITI 194262,705 viewsDJLAKAY 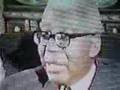
- 0:57Added to
queue Papa Doc of Haiti (Dr. Francois Duvalier, 1907 ...59,231 viewsSmithGeorges 
- 1:20Added to
queue Francois Duvalier 196823,202 viewswilnernau 
- 7:57Added to
queue Mr.Jean Bertrand Aristide & Mr. Jean Claude Duv...131,875 viewsledoyentv 
- 1:07Added to
queue Jean Claude Duvalier and Michele Bennet36,305 viewswilnernau 
- 10:00Added to
queue Port-au-prince in the 40's and 50's105,168 viewsniggadon47 
- 2:52Added to
queue 2009 WISHES FROM JEAN CLAUDE DUVALIER (BABY DOC)47,229 viewsTeleLakaytv 
- 28:06Added to
queue EX PRESIDENT ARISTIDE GRADUATED WITH A DOCTORAL...65,955 viewsVALABAB 
- 4:31Added to
queue San Mele (Adje) by Zekle (Haiti music)67,199 viewsambreginny 
- 5:26Added to
queue Jean Claude Duvalier74,992 viewswilnernau 
- 7:46Added to
queue Francois Duvalier 1968 ( Part 3)20,235 viewswilnernau 
- 7:52Added to
queue LAVALAS ET DUVALIERISTES !36,850 viewsVALABAB 
- 1:47Added to
queue Francois Duvalier31,990 viewswilnernau 
- 0:50Added to
queue Francois Duvalier7,799 viewswilnernau 
- 5:19Added to
queue COUPE CLOUE 1983 HAITIAN
|
Méssage pour vous jeunes Universitaire, écolier, Professionnel haïtien l’heur de la révolution est arrivé.
La conscience et la dignité vous frappe a la porte ouvre lui, et laissé lui vous parlez Car : le destin de ce pays est entre nos mains, ne nous laisse pas manipulé par ses anciens pillagets et opportunistes. Défendons nous notre avenir Comment stimuler l’économie productive ? L’Etat, la dignité... et la colèreRassemblés en janvier 2010 à l’université de Nottingham, une centaine de chercheurs ont tenté d’éclaircir la signification politique de la « vague rose », cette série de victoires électorales de la gauche (ou du centre-gauche) dans la plupart des pays latino-américains, entre 1998 et 2006 . Ce phénomène — nouveau — d’accès « massif » au pouvoir a conduit la plupart des intervenants à rouvrir un vieux débat, à l’aune de l’expérience politique d’une région où son intérêt ne se borne plus à la théorie : faut-il s’emparer de l’Etat pour changer le monde ? Le premier constat, c’est que la droite, elle, ne s’en prive jamais. « Dans les années 1980, observe William Robinson, professeur à l’université de Santa Barbara (Californie), une fraction des classes dominantes évince l’élite traditionnelle et s’empare du pouvoir d’Etat pour faciliter le processus de mondialisation libérale... dont elle tire le plus grand profit. » Ainsi, la montée en puissance des néolibéraux a au moins un mérite : elle démontre qu’en « s’emparant du pouvoir d’Etat » il est possible de « remettre en cause le statu quo ». Encore faut-il véritablement le souhaiter. Pour Juan Grigera et Luciana Zorzoli, deux chercheurs argentins, ce n’est pas vraiment ce qui caractérise la présidence de M. Néstor Kirchner en Argentine (2003-2007) : « Son rôle fut de restaurer la gouvernabilité du pays », tout en s’assurant qu’« on ne toucherait pas au modèle économique ». Pis, observe Sara Motta, de l’université de Nottingham, à propos cette fois du Brésil, de l’Uruguay et du Chili, « le renforcement de la démocratie s’accompagne dans ces pays de mesures sociales d’assistanat qui mènent à une “naturalisation” de la pauvreté », selon l’idée que les inégalités feraient partie de l’« ordre des choses » et qu’il faudrait finalement constater l’impossibilité de les éradiquer... En pleine crise du modèle néolibéral, souligne Motta, on perçoit aisément l’intérêt, pour les classes dominantes, de voir arriver au pouvoir des gouvernements qui, « supposément issus des classes populaires, affaiblissent la (...) Cet article sera prochainement disponible en version intégrale Archives 2010 Seule l’éducation résiste par Tom Amadou Seck. — mai 2010 L’Etat, la dignité... et la colère par Renaud Lambert. — avril 2010 Et la pauvreté s’invite dans le débat britannique par Eric Dupin. — avril 2010 L’Enigme du retour par Christophe Wargny. — mars 2010 Haïti, la tectonique de la misère par Christophe Wargny. — février 2010 Vers la disparition des peuples papous en Indonésie ? par Philippe Pataud Célérier. — février 2010 Le tabou des excréments, péril sanitaire et écologique par Maggie Black. — janvier 2010 |
Haïti 1983. Photo F.& F. Biaggi. Reconstitution d’une communication présentée sur notes à l’«Interamerican Dialogue» du mercredi 20 avril 2005 à Washington D.C. I.- Un rappel introductif d'éclairage du contexte thématique Depuis un demi-siècle, ce pays d'Haïti connaît un des plus grands changements sociaux de son histoire: la massification qui a lancé l'initiative des masses vers l'irruption directe dans la politique et la vie sociale consciente. Ce recentrage des acteurs politiques et sociaux est reflété dans les nouveaux noms de famille émergeant dans la notoriété et dans le registre de la notabilité. Le poète Jean Brierre, revenant d'un long séjour en terre africaine, s'écriait : Je ne connais pas ces gens-là d'aujourd'hui et ils ne me connaissent pas. Il est courant d'entendre dire à des visiteurs haïtiens de l'élite traditionnelle en revenant au pays pour un bref séjour: je ne reconnais pas ma ville. C'est que son contenu social a changé. Quel va être le comportement politique de ce nouveau pays et surtout son comportement électoral au bout d'un processus qui a vu l'échec de deux populismes successifs: le populisme fascistoïde de François Duvalier et l'anarcho-populisme d'Aristide, et en refus actuel d'un troisième populisme dont le spectre n'est pas encore définitivement écarté? Qui seront les dirigeants politiques de demain et qui doit avoir peur du suffrage universel? Mais le pays traverse depuis un siècle la plus grave et plus longue crise de son histoire nationale: la crise structurelle de la société traditionnelle Haïtienne en voie de dépérissement: «the passing of a traditional society». Mais le traditionalisme, tout en mourant, est encore assez vivace pour continuer à occuper les avenues et bloquer l'avènement de la société moderne. Celle-ci, cependant, frappe à la porte avec pugnacité et à défaut de pouvoir entrer, elle se répand en enclaves de modernité dans la réalité du pays. La crise, nous dit Gramsci, c'est quand l'ancien résiste encore efficacement alors que le neuf veut l' emporter. C'est l'Haïti de la vraie et profonde transition, ce que j'ai appelé un «hiatus inter-systémique». Quel levier fera basculer définitivement le système vers l'abîme de l'échec d'un traditionalisme en décomposition à la suite de la descente actuelle aux enfers ou décisivement la poussée novatrice de la modernité émergente? L'évolution conjoncturelle place au premier plan de l'actualité les «trois D»: le désarmement, les décaissements et le dialogue national. Deux de ces trois urgences dépendent en priorité de l'étranger interventionniste et le troisième risque d'entrer en conflit avec les élections programmées, ce qui crée une contrariété tendancielle des agendas. Au fond, la pauvreté Haïtienne, est-elle à la phase terminale du cancer? Depuis quand donc Haïti est irrémédiablement pauvre à l'agonie? Il ne faut pas s'empresser de répondre: depuis toujours car on peut avoir des surprises. Mon amie canadienne économiste sociale Kari Levitt m'assurait, analyse comparée en mains, qu'il fallait ré-évaluer en hausse le PNB par tête d'Haïti par rapport à la Jamaïque par exemple, cependant de toute évidence nettement plus évoluée économiquement De toute façon, c'est un pays en détresse mais en attente. Le dernier mot n'est pas dit. II.- Variations sur la problématique générale et évolutive de la pauvreté haïtienne Le mot de pauvreté est aussi vieux que le monde, mais sa réalité a été perçue différemment, selon l'époque, les cultures et civilisations, l'impact des conditions climatiques et les variations dans le rythme de l'évolution démographique comme pression sur les ressources disponibles. C'est un truisme de dire que toutes ces variables ont joué dans le cas Haïtien qui nous occupe aujourd'hui comme ailleurs, avec une intensité changeante au gré des circonstances. Mais le jeu de ces variables a été inventorié et on sait sur lesquels on peut jouer pour agir conséquemment, je veux dire en connaissance de cause. Il y a une stratégie opérationnelle dans la lutte contre la pauvreté, au moins pour la réduire en fonction des moyens disponibles appropriés. La pauvreté a même été un idéal de vie ou même une condition pour la sainteté, et en tout cas, elle a été considérée comme naturelle pendant longtemps. Il y a pauvreté quand les besoins primaires d'une population ne sont pas satisfaits, et cela commence par le manque collectif de nourriture pour atténuer sa faim, premier signe de la pauvreté structurelle, suivi des carences graves de la santé ou maladies et de la privation d'éducation ou ignorance, en tête de liste des besoins sociaux de l'individu. Cette insatisfaction des besoins sociaux de l'individu va se répercuter sur les problème de structure sociale pour étager les strates, couches, catégories et classes que recouvre le champ de la pauvreté, dans la problématique «classes laborieuses, classes dangereuses» du baromètre de la contestation exprimée dans la «question sociale». Le cas Haïtien montre la relation entre la pauvreté subjective, relative et même acceptée pendant longtemps, et la pauvreté objective, concrète et absolue qui frise le seuil de l'inacceptable vu les inégalités sociales intenables. La pauvreté massive est atteinte quand «le coût de l'homme» pour employer un mot de François Perroux n'est pas du tout assuré pour la grande majorité de la population, comme c'est la réalité de l'Haïti contemporaine. On comprendra que mes propos présents d'ouverture du débat sur le dossier de la réduction de la pauvreté Haïtienne prennent en considération que deux des panélistes sont membres respectivement de la Banque Mondiale et de la Banque Interaméricaine de Développement et donc en charge des aspects techniques et quantitatifs du sujet. Ceci m'amène à mettre l'accent sur la dimension humaine générale et historique du problème et sur les variations dans la poursuite du combat pour la réduction ou l'éradication de la pauvreté dans une stratégie de confrontation à venir avec la pauvreté structurelle en Haïti, à commencer par sa dimension politique – le primat du politique – quand enfin dans notre pays on acceptera de «faire la politique autrement ». III.- Variations sur le thème de la pauvreté dans la problématique de l'évolution socio-économique Haïtienne On peut dire de la pauvreté que, comme la nostalgie, elle n'est plus ce qu'elle était La pauvreté en Haïti a une consonance particulière qui lui vient de l'histoire. Le mot, en effet, est associé au binôme café et vivres qui a réglé l'économie haïtienne jusqu'aux temps récents, le café comme la base majeure d'exportation soutenant l'économie entière, et les vivres comme l'élément local de base de la production et de la consommation pour l'économie nationale. Le café est connu pour avoir assuré l'opulence d'une riche minorité de spéculateurs et d'exportateurs de l'élite urbaine, mais aussi pour avoir pourvu les ressources globales minimales pour garantir la provision monétaire dans les jeux des échanges. Les vivres ont assuré le matelas de sécurité pour une majorité paysanne souvent aisée dans le champ de la production et assurant un excédent «commercialisé» du labeur paysan. Cette aisance vivrière a pris son origine dans la destruction du système de la plantation pendant la révolution Haïtienne créatrice, par le morcellement, d'une structure agraire finalement dominée par la moyenne et la petite propriété. Une authentique paysannerie a émergé dans une abondance vivrière pour beaucoup sinon pour tous, au point de devenir légendaire sous le qualitatif de «bonheur vivrier» ponctuée en outre par les retours annuels réguliers et providentiels de la saison des mangues. Bien sûr cette description ne manquait pas d'être idyllique, mais le fait indéniable est que tout cela mettait une sourdine sinon même un masque sur la pauvreté persistante de l'économie Haïtienne. Pour sûr, les statistiques d'une pauvreté rampante avaient beau être déjà là, mais pour exprimer la qualité de la vie, le genre de vie n'avait pas besoin de statistiques pour confirmer ou dissiper les perceptions. Ecoutons nos dictons d'hier dans leur insouciance des chiffres: là où il y en a pour 7, il y en a pour 10, et plaie d'argent n'est pas mortelle ou une progéniture nombreuse est une bénédiction. Il y avait une distance sinon même un fossé entre les preuves statistiques montrant la pauvreté chez nous, et les modèles de comportement d'accommodement avec elle pour la nier ou la masquer, une question de «décorum» polyclassiste. Ainsi, la pauvreté rampante a pu n'être pas un problème, à cette ère pré-statisque ou extra-statistique quand elle ne s'exprimait pas en souci collectif pour une politique publique contre une pauvreté qui n'était pas encore perçue comme massive. Chacun en connaissait des cas ou des lieux, mais la pudeur dite «petite-bourgeoise» (?) les faisait taire. Et puis, qui voulait tendre son bol ou son «coui» de mendiant professionnel? La parenté (ou la proximité qui en tenait compte car voisinage cé fanmi) était le recours – économie familiale - ou alors les poches de pauvreté stricte ou excessive étaient laissées à la diligence généreuse des institutions religieuses de charité comme depuis le Moyen-âge européen. Mais les temps d'Haïti chérie sont révolus comme soudainement. Et avec l'ère post-caféière, compagne d'un déficit croissant concomitant de vivres, la pauvreté persistante devient une réalité manifeste et aveuglante, et donc désormais perçue comme telle, et cette reconnaissance de la pauvreté massive Haïtienne est irréductible à l'effet de ponction démographique que constitue l'émigration devenue massive elle aussi. L'explosion démographique – de 500'000 habitants en 1804 à plus de 8 millions d'âmes en 2004 – et la micro-propriété devenue dominante – de 25-30 carreaux de moyenne d'exploitation familiale en 1816 à un demi carreau en 1996 - ont eu l'effet combiné et cumulatif de détruire la relation «équilibre et population» C'est alors, c'est-à-dire maintenant, que la pauvreté devient statistique en Haïti, par exemple l'espérance de vie 49, 4 en 2002 (contre 81,5 au Japon et 80 ans en Suède) ou le taux d'alphabétisation des adultes 51,9 (contre 99.7 en Barbade et 98,5 à Trinidad). IV.- Les recettes d'une prescription éprouvée mais à rénover: une trinité stratégiquement concordante, nouvel impératif de la conjoncture Quoi faire pour éradiquer la pauvreté ou la réduire à un seuil supportable dans la société globale en accélérant le rythme du progrès social? Je ne suis pas ici pour contester ni sous-estimer la fécondité des méthodes et techniques les plus aptes à propulser le progrès social dans la bibliographie de la thérapie sociale corrective de la pauvreté, en y incluant les tâches modestes mais importantes des «social workers» (travailleurs sociaux) pour améliorer l'environnement de proximité en vue de réduire la pauvreté localement, sur le terrain. J'y pense au contraire dans le cas préoccupant de la délinquance urbaine juvénile Haïtienne pour laquelle la justice répressive, qui ne doit pas perdre ses droits, peut trouver cependant des tempéraments guérisseurs dans le traitement des drames sociaux de la pauvreté qui sont associés à l'existence de cette délinquance juvénile sinon même à son origine. Je m'efforce de rester au courant du fait que la sous-traitance, les «joint ventures», les zones franches et le micro-crédit, par exemple, sont à l'agenda du secteur privé Haïtien et des investisseurs étrangers pour y rester, en vue de générer la croissance et l'expansion économiques pourvoyeuses de «jobs» et de dividendes sociaux ou retombées sociales. Je me réjouis que de nouveaux produits ont pris ou peuvent prendre la relève du café pour le marché des exportations comme les mangues, le ricin, la papaye et le retour des huiles essentielles, et que des favorites de la diaspora peuvent être dynamiquement propulsées localement comme le rhum Barbancourt, les champignons noirs («djon-djon») et le lambi pour la consommation extérieure des Haïtiens de l'étranger à des fins sociales par la voie indirecte de l'enrichissement économique engendrant une meilleure circulation et distribution de la richesse. Mais si je suis à cette table de conférence, c'est pour braquer le projecteur et les feux de la rampe en vue de démontrer la centralité d'une thèse déjà ancienne et mienne, à savoir que pour réduire ou essayer d'éradiquer la pauvreté en Haïti, vu ce qu'est devenu le contexte Haïtien actuel, signifie une stratégie politique consistant à réaliser graduellement mais simultanément les trois modernisations: la modernisation politique (que nous appelons aujourd'hui la démocratisation, incluant les élections libres, le pluralisme politique et la promotion des droits humains), la modernisation économique (que nous appelons aujourd'hui la croissance auto-soutenue et le développement durable) et la modernisation socioculturelle (que nous appelons aujourd'hui le développement humain poursuivi dans l'épanouissement individuel par la justice sociale et l'équité vers un objectif de chances égales pour tous). Le fait est qu'avec la véritable transition à venir après les élections attendues en 2005, nous serons obligés d'effectuer le triple décollage des trois processus en même temps, pour avoir raté les opportunités de la seconde moitié du 19ème siècle et du premier quart du 20ème comme pays indépendant parmi d'autres tels le Japon de l'ère Meiji (grand changement) pour le modèle duquel l'élite para-féodale Haïtienne d'alors se passionnait, ou la Chine nationaliste de Sun Yat Sen dont la révolution suscitait une vie curiosité alimentée par les correspondants locaux dépêchés sur place, ou la métamorphose de la Turquie de Mustapha Kemal Ataturk dont on sait qu'elle hantait l'esprit du jeune François Duvalier et l'Ecole historico-culturelle «Les Griots». Ayant raté le train, Haïti fit alors son entrée en sous-développement. Les trois modernisations se doivent désormais être une performance concomitante alors qu'ailleurs, elles se sont échelonnées en trois phases : la première, généralement économique, puis la seconde politique et finalement la troisième socioculturelle, parce que changer les mentalités est plus difficile à réaliser que diviser un atome. Les transferts opérés par la diaspora vers Haïti et les anticipations d'investissement à venir de celle-là ne sont pas encore des substituts pour l'impulsion qui doit venir de l'intérieur, cette impulsion endogène qui culminera en progrès social. De là la nécessité de la stratégie trilogique concordante pour gérer cette impulsion. Ces trois modernisations nécessaires à mener à bien simultanément ont au moins deux conséquences opérationnelles: le gradualisme dans la stratégie frontale pour combattre la pauvreté, mais aussi un dosage évolutif entre les trois Un cours graduel par étapes est, en effet, indispensable dans la poursuite des trois modernisations simultanément conduites. Mais aussi un dosage évolutif doit être de pratique appropriée, pour justifier pourquoi, quand et comment. Tout est dans le dosage. On trouvera logique d'inaugurer la modernisation économique par une dose relativement plus forte au départ, tandis que progressivement on aura à renforcer le volet de la modernisation sociale quand une telle accélération deviendra possible parallèlement à la normalisation et à la stabilisation du processus électoral grâce à l'état de droit. De là l'importance clef d'élections acceptables pour être acceptées. Précisément pour lier le problème de la pauvreté avec l'actualité politique de la compétition électorale déjà entamée, trois questions ont été aditionnellement posées dans ce panel consacré à la pauvreté. Il est difficile et hasardeux de répondre à la première: comment les élections à venir seraient-elles impactantes sur la réduction de la pauvreté? Les débours de l'organisation des élections et de la campagne électorale sont une manne vite distribuée au niveau de la base en portions infinitésimales – le traditionnel clairin rural sera encore de la partie -, donc d'un impact quasi-nul sur les efforts de réduction de la pauvreté. L'effet des élections peut cependant être de créer un climat de nouveau commencement comme pour en finir enfin avec la transition donc le provisoire, et ouvrir la voie à la stabilisation d'un nouveau cours des affaires, J'appellerais cela un effet d'anticipation sur les expectations d'un mieux être social. Enfin sur le plan international, la volonté politique que les élections soient faites comme la détermination affichée que cette volonté soit faite, laisse augurer une préparation d'un tournant positif de la coopération internationale. Notons que, dans un article paru dans «Vision», périodique publié par le CSIS de Washington, j'ordonnançais le processus de démocratisation lui-même en trois étapes correspondant au rythme des deux autres modernisations, en plaçant la candidature d'Haïti au décollage pour les débuts renouvelés du processus de la démocratisation en 1986, en un essai à transformer, comme on dit en rugby. Ceci devait correspondre à l'inauguration chez nous de la «révolution démocratique» dans ce triplet stratégique pour le développement humain précédant de près, selon notre programme de gouvernement en 1988, le «package» de politique publique pour pousser en avant le processus de l'équité sociale avec le rôle de l'Etat, du secteur privé et du monde des travailleurs comme trois partenaires. On y voyait l'embryon de la réalisation du rêve de «l'économie sociale de marché» chère aux démocrates-chrétiens et aux socio-chrétiens, fondée sur le système de la libre entreprise, mais avec une stratégie intelligente pour réduire la pauvreté, non seulement en augmentant le gâteau en vue de sa répartition, mais mieux en envisageant les modalités d'une distribution équitable des portions au moment même d'en concevoir la production, ce qui affectera cette production elle-même dans ses modalités et dans sa finalité. Produire est un impératif exigeant qui demande beaucoup de travail (hard work). Du modèle de l'ère Meiji du Japon d'hier à celui de Taiwan de la Chine d'aujourd'hui, le trait commun est ce «hard work» dans la réalisation des trois modernisations, de l'une à l'autre et d'un stage à l'autre, en termes de gradualisme et de dosage L'essentiel, de toute manière, est qu'il faut une synchronisation entre les trois modernisations simultanément conduites: une véritable «symphonie concertante». |
![HAITIAN ART [alan cavé :je fèmen ]](http://i1.ytimg.com/vi/pvUQpomeuGw/default.jpg)